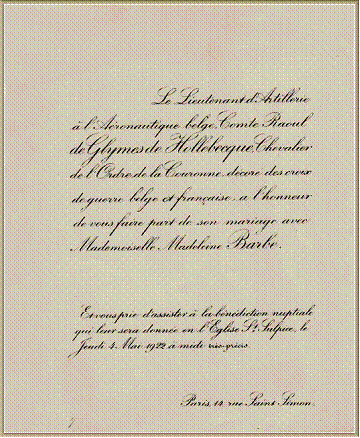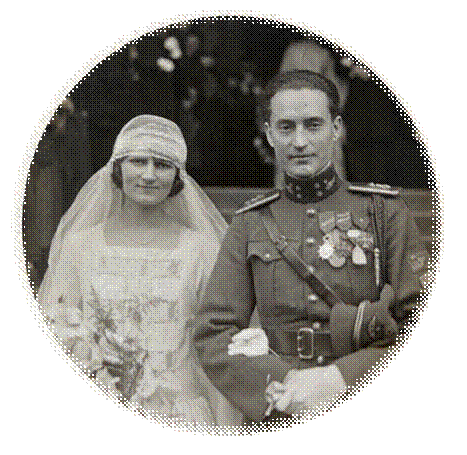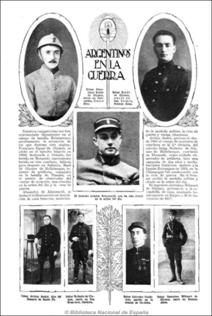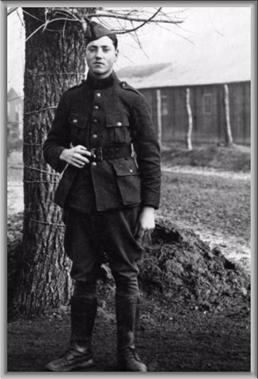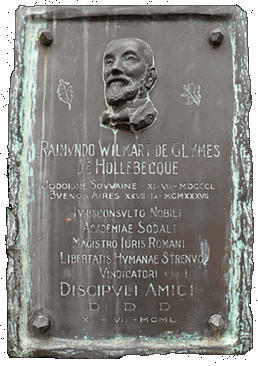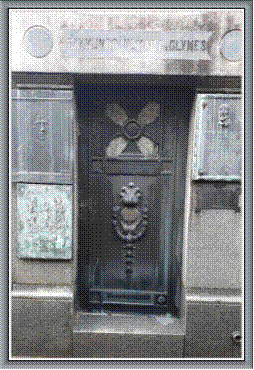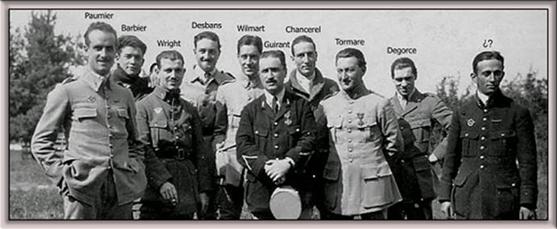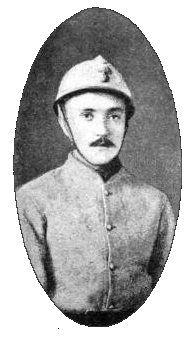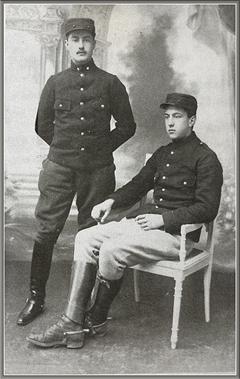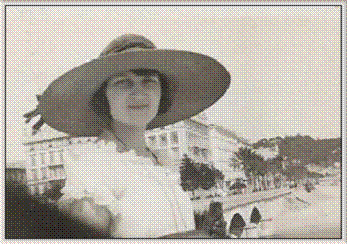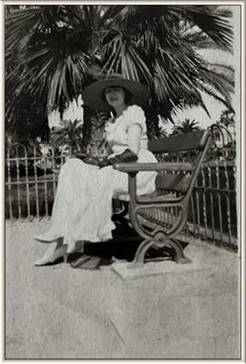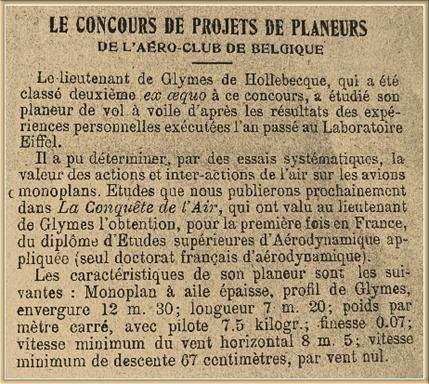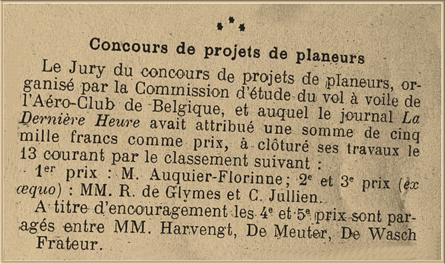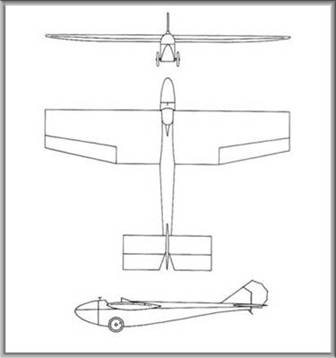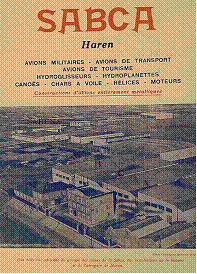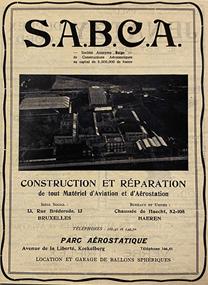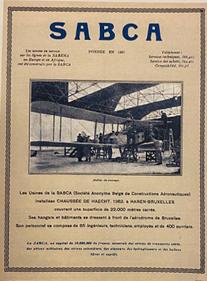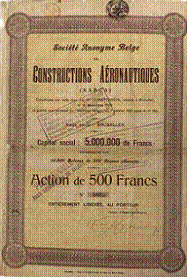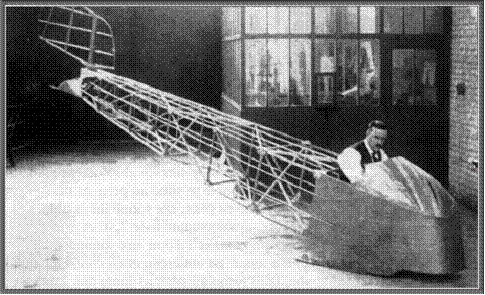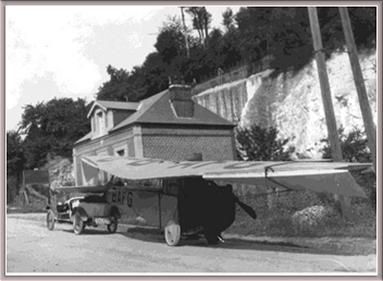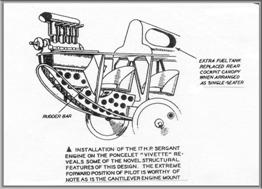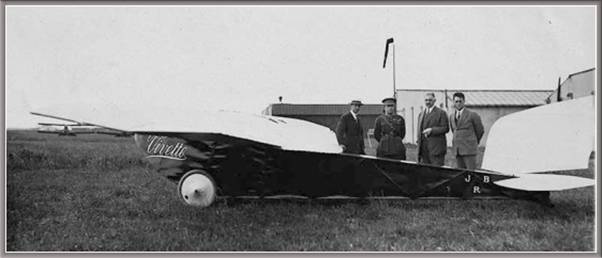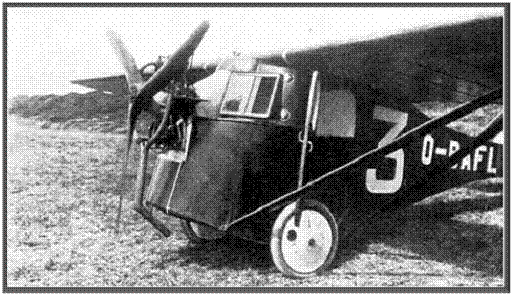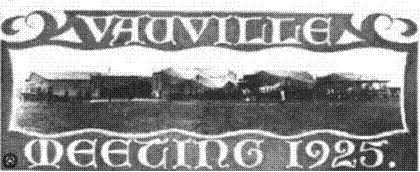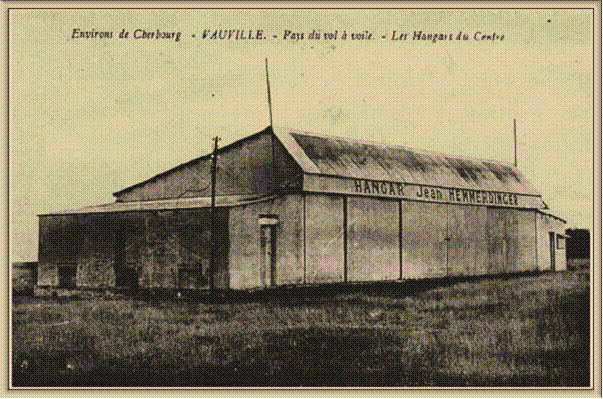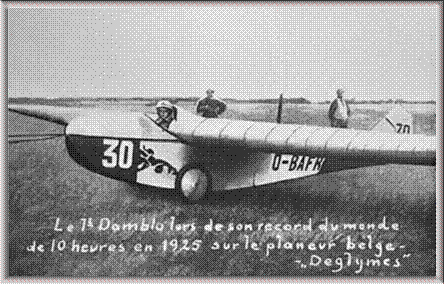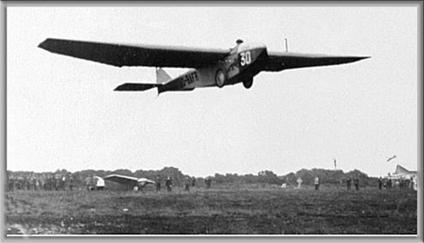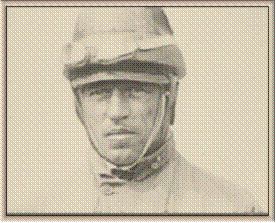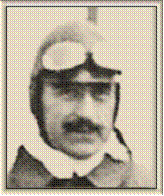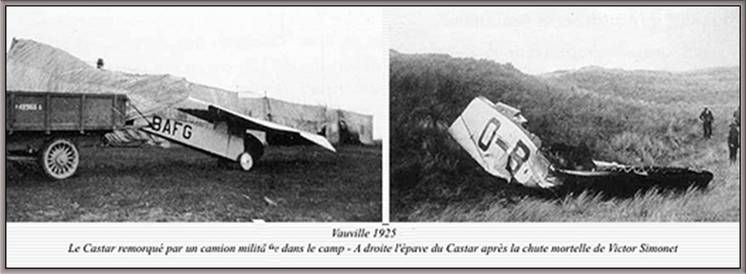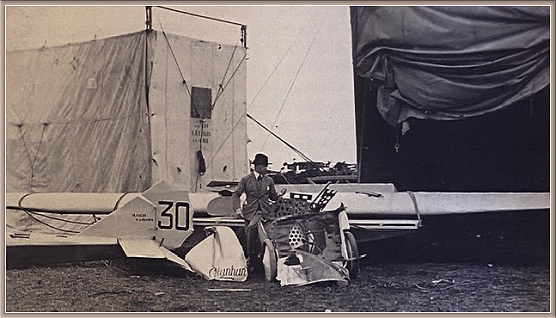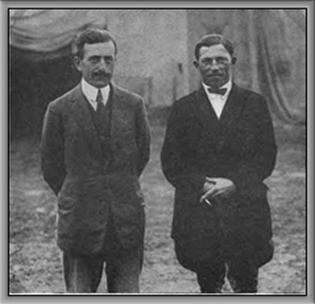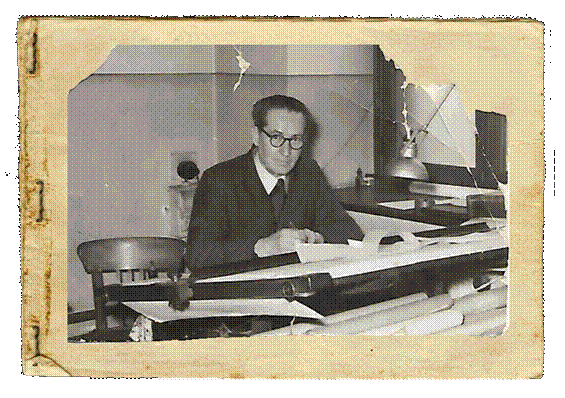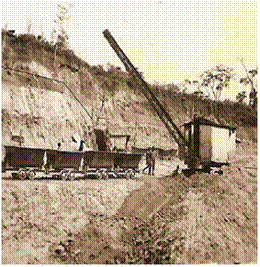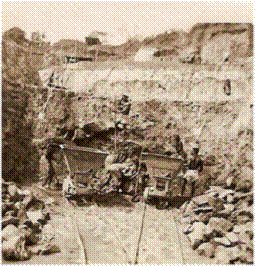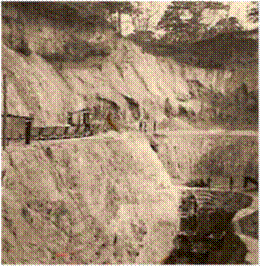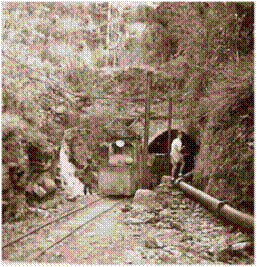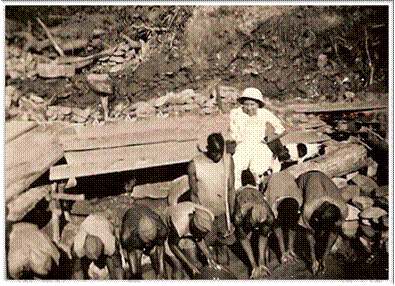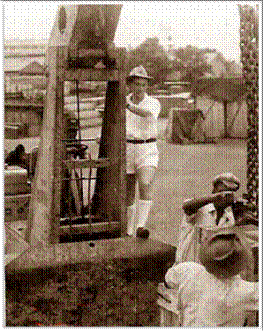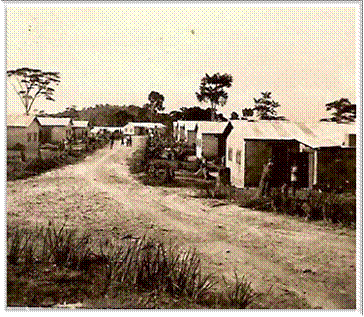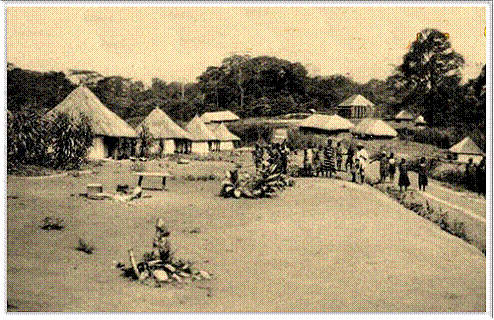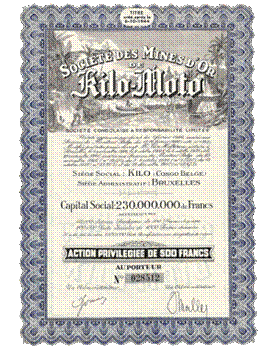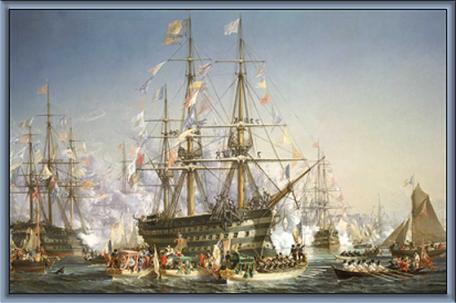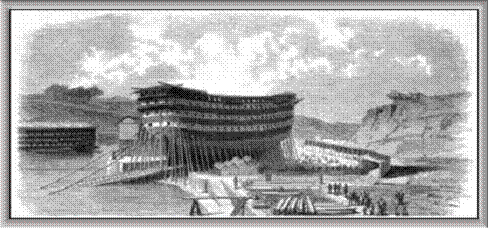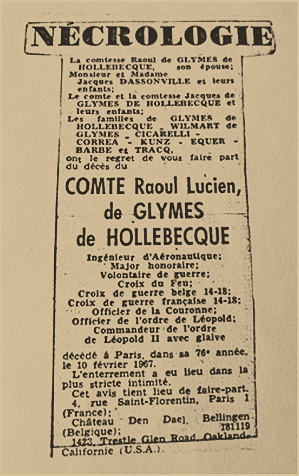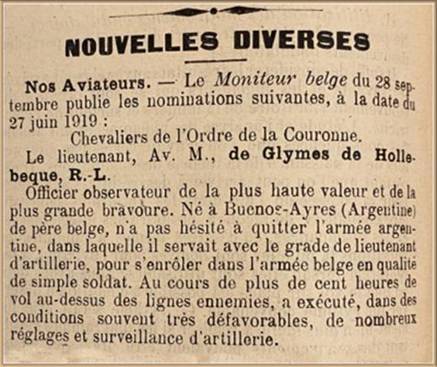|
Pionnier de l'aviation
belge
Raoul-Lucien de
GLYMES de HOLLEBECQUE est un descendant des Comtes de Glymes de Hollebecque
et du Saint Empire, famille d'ancienne chevalerie, originaire du Duché de
Brabant (XIVème siècle). Raoul descend du Duc Jean II de Brabant.
Armes : d'azur billeté
d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout.
Raoul de Glymes
de Hollebecque est né à San Isidro province de Buenos Aires en
Argentine, le 30 janvier 1892. Il est décédé à Sartrouville dans les Yvelines
en France, le 10 février 1967.
Il était le fils
du Comte Ernest de GLYMES de HOLLEBECQUE, né le 14 mars 1860 au Château de
Jodoigne-Souveraine en Belgique et de
Mercedes-Elysa PEREYRA del PUERTO, née en Argentine en 1866,
décédé en Argentine en 1922. Elle était la fille du
Colonel Olympides Peyreyra, gouverneur de la province de la Rioja
et de Juana (Juanita) PEYREYRA del PUERTO, descendante d'une famille
noble d'Espagne.
https://gw.geneanet.org/dassonville_w?lang=en&p=laure&n=dassonville&oc=2
Son père avait émigré en Argentine et
fut Directeur de la Banque Nationale à Buenos Aires. Ernest de GLYMES de
HOLLEBECQUE mourut à Jujuy en Argentine le 12 mars 1916 et son épouse,
Mercedes, mourut à Buenos Aires (Argentine), le 16 mai 1885. Son oncle,
Raymond (Raimondo) de Glymes (Wilmart) qui était avocat à Louvain (Belgique)
avait émigré avant lui en Argentine où il fut professeur de Droit romain à
l'Université de Buenos Aires. Raymond était né le 11 juillet 1950 à
Jodoigne-Souveraine (Belgique) et il est décédé à Buenos-Aires le 29
septembre 1937. Il y fit venir sa famille, dont son frère Ernest, le père de
Raoul. Raoul avait épousé à Paris le 4 mai
1922, Madeleine-Louise-Julie BARBE, née à Paris 14ème, le 21 avril 1902,
décédée à Anderlecht (Belgique), le 26 décembre 1994. Elle était la fille
d'Eugène-Nicolas BARBE, professeur de Sciences Littéraires au Lycée Condorcet
à Paris, né le 3 août 1857 à Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne), décédé à
Paris 6ème le 7 juin 1916 et de Laure ALLIER, sans profession, née à Lille
(Nord), le 14 juin 1873, décédée à Paris 6 ème le 15 septembre
1947.
De leur union, sont nés deux enfants : Anne-Mercedes-Suzanne-Renée de GLYMES
de HOLLEBECQUE, né à
Etterbeek (Belgique), le 22 janvier 1922, décédée à Saint -Raphaël (France),
le 1er janvier 2009. Elle avait épousé Jacques
DASSONVILLE, ingénieur chimiste.
Gérard DASSONVILLE marié à
Isabelle Sonck. Ils ont eu un fils Olivier DASSONVILLE
Jacques de GLYMES de HOLLEBECQUE, né à Etterbeek (Belgique), le 5 janvier 1924,
décédé le 6 avril 2004 à Oakland (USA). Il avait épousé Léone LAFLEUR et ils
ont eu 2 enfants : Françoise de GLYMES de
HOLLEBECQUE (décédée), marié à Maurice TRACK. Il ont eu deux enfants : Daniel
et David de TRACK
Raoul de Glymes, son épouse
Madeleine (Made) et leur fille Anne
A l'âge de 14 ans, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE fut interne au collège de San Carlo à Buenos Aires. Il rêvait de voir la Belgique, terre de ses ancêtres, devenir belge et servir la patrie de son père. Après ses études, âgé alors de 16 ans et très
attiré par le métier des armes, il entra à ses frais, en 1908, à l’Académie
militaire Argentine, où il eut comme professeur, le Colonel d’artillerie
belge Kestens. Raoul choisit naturellement cette arme et il reçut le
grade de sous-lieutenant en 1909 et de lieutenant en 1912.
En 1911, Raoul fut nommé
chef de section de la 2ème batterie du 2ème régiment
d’artillerie, avec laquelle il avait participé en 1912, aux grandes manœuvres
d’El Azul. Comme major de sa promotion, il choisit la garnison de Buenos
Aires ce qui lui permit d'étudier, en élève libre, les cours de diplomatie à
l’Université de la capitale argentine. En 1915, le premier conflit mondial éclate et désireux depuis longtemps de voir la terre de ses ancêtres, la Belgique, pays qu'il ne connaissait pas, il embarqua avec son frère Ernest-Roberto de Glymes (Robert) à bord d'un bateau pour rejoindre l’Europe et ils arrivèrent à Marseille le 19 novembre 1915. Dès leur arrivée à Marseille, les 2 frères s’adressèrent au bureau de recrutement et rejoignirent immédiatement l'artillerie de l'Armée belge comme simples soldats, volontaires de guerre. (le service militaire était devenu obligatoire en Belgique ! )Ils obtinrent tous les deux leur nationalité belge. Etant donné sa spécialisation, Raoul de Glymes fut envoyé au Centre d’Instruction de l’Artillerie belge à Eu (Seine Maritime) et il fût nommé sous-lieutenant et chef de la 2ème batterie d’obusiers de 105 mm en position à Reninghe (Flandre Occidentale). Le 12 août 1916, il fut muté à la 33ème Batterie de 75 mm, en position à Oudekapelle (ville belge près de Dixmude) et son courage lui valu d’être félicité par sa Majesté le Roi Albert 1er.
Sa batterie agissant en étroite collaboration avec l’aviation, Raoul de GLYMES, conquit par cette nouvelle arme, vit son avenir dans les airs. Le 25 mai 1917, il obtint son brevet d'observateur aérien à la 3ème escadrille, qui était alors basée à Saint-Idesbald (Flandre Occidentale) et son premier vol se fit sur un Farman F40. En juin 1917, ce terrain, ayant été jugé trop proche des lignes allemandes, la 3ème escadrille s’installa aux Moëres dans le Nord de la France. Ensuite, basée à Houthem (Hainaut), commandée par le capitaine HEDO, cette escadrille qui était équipée de Farman F- 40 fut chargée avant tout de réglage de tir.
Farman F40 sur lequel Raoul de Glymes fit son premier vol en 1917
En février 1918, la 3ème escadrille,
commandée par le capitaine DHANIS, reçoit les nouveaux Breguet XIV (Biplans
conçus en France et utilisés pendant le première guerre mondiale. Ils
servaient comme avions de reconnaissance ou de bombardiers).
(chasseur de reconnaissance et
bombardier)
Depuis l’aérodrome
de Bockum – Krefeld, près du Rhin, les pilotes poursuivirent leurs
missions dans le but de ramener des clichés de sites industriels et
militaires pour l’Etat-Major des troupes d’occupation.
Le commandant de ZOYTHYDT,
le capitaine MOROY, le capitaine BIVER, le capitaine BARYTHELEMY, le lieutenant
DUCELLIER, le lieutenant de GLYMES, le sous lieutenant MOUTON, le
sous-lieutenant MEEUS le sous-lieutenant VERGUET, l’adjudant de BROCHOWSKI,
l’adjudant VILAIN XIIII, l’adjudant BRUGMANS, le sergent VAN MELLE et le
sergent VAN OPSTAEL.
Raoul de Glymes participa à de nombreuses missions
d’observation aérienne au-dessus des lignes ennemies. Il fut cité à l’Ordre
du Jour de son unité et décoré de la Croix de Guerre, ayant au moins effectué
76 missions de guerre. Il fut également nommé Chevalier de l'Ordre de la
Couronne le 27 juin 1919 .
Moniteur belge du 28 septembre
1919
Parmi les nombreux argentins qui participèrent à la Grande Guerre,
citons :
Robert de
GLYMES (Roberto), frère de
Raoul, qui combattit également en tant qu'observateur dans l’Artillerie
belge, mais sur le front de Dixmude.
L'oncle de Raoul et Robert de GLYMES de HOLLEBECQUE Raymond - Louis - Joseph de
GLYMES de HOLLEBECQUE, citoyen belge et jeune avocat à Louvain (Belgique),
débarqua au printemps 1873, âgé de 22 ans, dans le port de Buenos-Aires,
envoyé par karl Marks pour y diffuser la doctrine communiste,
promouvoir le socialisme à Buenos-Aires et étendre les réseaux de la Première
Internationale (Association internationale des travailleurs fondée le 28
septembre 1964) en Amérique du Sud. Raymond était ami avec Laura, la fille de
Karl Marks et son gendre Paul Lafargue. Son enthousiasme était intense et
Karl Marks avait vu en lui "courage, fraîcheur et conviction". Son
objectif n'était autre que de faire la révolution socialiste en Argentine.
Avant son départ pour l'Argentine, le jeune communiste avait déjà un mandat d'arrêt émis par la police belge et il a donc dû changer son plan initial de partir à Buenos-Aires depuis le port de Bordeaux. Il s'est alors rendu clandestinement à Madrid, où il s'est réfugié, selon une enquête, dans la maison de José Mesa, un imprimeur qui fut introducteur du marxisme en Espagne. Quelques jours plus tard, il poursuivit son voyage vers Lisbonne où, le 19 octobre 1872, il s'embarqua pour la capitale argentine. Aux autorités
administratives, il avait déclaré s’appeler Raymond WILMART de GLYMES de
HOLLEBECQUE et être né à Jodoigne-Souveraine, le 11 juillet 1850.
Sa fille Maria-Clara mariée à Antonio PODESTA lui donna son petit-fils le plus célèbre, le prêtre Jéromino PODESTA. Celui-ci, scandalisera les secteurs conservateurs de l'Eglise catholique Argentine lorsqu'il est devenu évêque ! En 1966, Podesta rencontra Clélia LURO, séparée de son mari et mère de 6 enfants. Il a commencé une relation avec elle qui a conduit à sa démission d'évêque l'année suivante. En 1972, il épousa Clélia. Parfois, sa femme et lui
célébraient la messe ensemble. Si il est parfois qualifié de laïcité, il est
seulement suspendu de l'exercice du sacerdoce. Au moment de sa mort, il était devenu pauvre et il avait été largement oublié. Lorsque Podesta était mourant, l'archevêque de Bueno-Aires Jorje Mario Bergoglio (plus tard devenu le pape François) l'a contacté ainsi que sa femme. Il était le seul argentin à visiter Podesta à l'hôpital. Son épouse, Clélia Luro a dit plus tard que Bergoglio l'a défendue des attaques les plus vives du Vatican contre elle pour avoir épousé Podesta.
Monseigneur Jéromino PEDESTA - WILMART ttps://en.wikipedia.org/wiki/Jr%C3%B3nimo_Podest%C3%A1 "Buenos-Aires,
7 décembre 1967" Ce qu'on appelle maintenant
à Buenos-Aires "L'Affaire Podesta" a connu mercredi un nouveau
rebondissement. Msg Jéromino Podesta, évêque du faubourg populaire
d'Avellaneda, a en effet publié un nouveau communiqué, dans lequel il affirme
avoir été calomnié par les autorités militaires et par le nonce apostolique
en Argentine. C'est à la suite de ces calomnies qu'il a été contraint de
donner sa démission acceptée par le Vatican. La plupart des journaux
argentins dénoncent ce qu'ils appellent "Le scandale de la démission
forcée de l'évêque d'Avellaneda. (Journal Le Monde le 8 décembre 1967). Jéromino Podesta était le
fils de la cousine germaine de Raoul de Glymes de Hollebecque (Maria-Clara de
Glymes de Hollebecque), décédé le 10 février, de la même année que lui, en
1967. Le père de Jéromino était Manuel-Antonio Podesta.
Raimundo Wilmart de Glymes
finit ses jours au sein de l'élite. Il est décédé le 29 septembre 1937 à
Buenos-Aires. Une nécrologie flatteuse parut où sont soulignés
ses contributions à la formation de la nation argentine ! Karl Marx et lui;
entretenaient une relation épistolaire, puisque de l'autre côté d l'océan, on
a retrouvé trois lettres que Raimundo envoyait à son mentor. Ces lettres ont
été perdues à jamais; brûlées par sa fille de peur de ternir la réputation de
son père et l'honneur de sa famille. "Brûlez les navires, pour qu'ils ne
les utilisent pas contre vous" ! Un élégant caveau fut construit dans le célèbre
cimetière de Recoleta à Buenos-Aire. Une inscription figure sur la
plaque du caveau
"Libertatis Humanae Strenvo Vindicator (Vigoureux
défenseur de la liberté humaine). La plaque principale montre, son visage de
bronze au menton légèrement relevé, un regard ébloui de trois quart de
profil, vers ce qui promet d'être une victoire. Il repose auprès de sa
femme Carlota Correas de Caceres Wilmart et de son fils Jéromino
décédé quelques jours après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Son
caveau sera vandalisé plus tard.
Porte du caveau et épitaphe de
Raimondo Wilmart de Glymes
Ci-dessus,
Raoul de Glymes avec son Nieuport
24 - 1997 Il mourut en héros
dans un combat aérien à Suippes dans la Marne le 1er novembre 1917, âgé de 39
ans. Il était toujours célibataire. Il fut inhumé dans le cimetière militaire
de Souain-Perthes-lès-Hurlus dans la Marne, un des plus grands
cimetières militaires de France de la Grande Guerre 14 -18.
Francis-Maurice-Hector EQUER de GLYMES (Francesco), autre cousin de Raoul, qui
s'engagea comme le précédent au service de la France et servit sur le front
d'Orient. Il fut blessé à Monastir en Tunisie et à Salonique
(actuel Théssalonique) en Grèce. Il était né à Cordoba en Argentine le 11 décembre
1899, fils de d'Eugène-Francis Equer né à Paris le 15 décembre 1855
et d'Odile-Marie-Josèphe de Glymes de Hollebecque, née au château de Jodoigne
(Brabant) en Belgique, 28 mai 1862.
Francis (Francesco) EQUER de
GLYMES Il est intéressant de penser à une Argentine dont tant de citoyens (43.000) sont partis combattre en Europe pendant la Première guerre mondiale. Compte tenu de la démographie du pays, c'est un nombre relativement important pour un pays qui est resté neutre.
A droite Jéromino de Glymes
Après la guerre, à son
retour d’Allemagne, le lieutenant Raoul de GLYMES demeura sous l’uniforme et
il fut admis à l’U.L.B (Université Libre de Bruxelles), pour y suivre les
cours de techniques d'aéronautiques du Professeur Allard et à Paris, les
cours de l’Ecole Supérieure d’Aéronautique où il reçut le diplôme d’ingénieur
en Aéronautique. Il s’inscrivit ensuite à l’Ecole Supérieure de Perfectionnement Industriel et effectua un stage d’un an au Laboratoire Eiffel. Diplômé d’études supérieures en sciences appliquées. Il obtint même le premier doctorat en sciences aéronautiques de France grâce au développement d'une maquette d'un nouveau profil d'aile qu'il essaya au laboratoire Eifel en 1922. C'est à cette époque qu'il
rencontra à Paris, sa future épouse, Madeleine - Lucie - Julie Barbe, fille
d'Eugène Barbe (né le 3 août 1857 à
Buzet-sur-Tarn, Haute-Garonne en France et décédé à Paris 6 ème, le 7
juin 1916 ) et de Laure Allier (née à Lille, Nord,
France le 14 juin 1873, décédée également à Paris 6 ème, le 15 septembre
1947). Raoul et Madeleine s'étaient mariés le 4 mai, 1922 à l'église de
St-Sulpice du 6 ème arrondissement de Paris.
En 1923, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE passa un doctorat en aérodynamique appliquée à l'université de la Sorbonne à Paris et il obtint un diplôme d'ingénieur civil de constructions mécaniques et aéronautiques. Raoul de GLYMES ayant orienté son intérêt vers le vol à voile et en attendant de gagner lui même ses ailes, étudia un monoplan, dont la maquette fut testée au Laboratoire Eiffel, pour mesurer les coefficients dynamiques. Les formes, profils et coupes furent déposés sous le brevet SGDG 158.132. Ce projet remporta le premier prix au concours de projet d’avions et moteurs de l'E.N.S.A (Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique) de 1921, et il fut classé second ex-æquo au concours de projets de l'Aéro Club de Belgique de 1923
Suite à ce succès,
l'ingénieur de GLYMES n'eut aucune peine à trouver un emploi lorsqu'il
fut démobilisé et le major George NELIS, dont le rôle fut important pour l'aviation
belge dans l'immédiat d'après-guerre, lui proposa de travailler à la SABCA
(Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques). Raoul de Glymes fut
engagé en 1930, comme chef de service de contrôle à la SABCA, créée peu
auparavant. Durant ses loisirs, Raoul de
Glymes poursuivit ses recherches personnelles et à titre privé, le lieutenant
Maurice DAMBLON lui demanda de lui étudier un planeur pour participer au 2ème
concours de Vauville en France en juillet 1925. Les ailes doivent être
démontables afin de pouvoir le remiser facilement dans une grange, aux abords
des pentes. Raoul de Glymes était alors,
ingénieur responsable de la qualité à la SABCA qui avait besoin d'un banc de
test en vol pour l'étude du rendement de la voilure et des interactions des
fuseaux moteurs et autres organes de son projet de bombardier "S
3". Le planeur naîtra donc de la conjonction de ce
projet et de celui de Raoul de Glymes breveté qui fut primé en 1921 et 1923.
Premières esquisses du planeur de
Raoul de Glymes
L'appareil, équipé d'un
moteur léger Anzani de 10 cv parcourut la distance Bruxelles
(Haren) - Saint Valery-en-Caux en France en Normandie (France). Le moteur fut
ensuite enlevé pour permettre au planeur de Glymes de participer aux
compétitions de vol à voile. Ce monoplan était extrêmement léger, entre
autres grâce à son fuselage et ses ailes couvertes de toile de soie huilée.
Le SABCA "de Glymes" aux
lignes racées et avant-gardistes
Les premiers essais
eurent lieu à Remouchamps le 23 décembre 1924 avec le lieutenant Maurice
Damblon comme pilote, qui réussit à voler 35 minutes, 4 secondes, 4/5 sur ce
planeur conçu par l'ingénieur de Glymes, battant le record mondial de vol à
voile. Ce fut le premier vol en planeur au-dessus de la Belgique.
Monoplan monoplace, il s’apparentait dans ses grandes lignes aux CASTAR et à la VIVETTE, construits également par Paul Poncelet à la SABCA. Il était cependant, pour sa voilure, dérivé directement d'un projet de trimoteur de transport ou de bombardement (SABCA S-3), qui ne vit jamais le jour, mais qui devait permettre d'étudier le rendement de cette voilure. Ces études furent exploitées dans la réalisation du trimoteur SABCA-S-II.
Caractéristiques Envergure : 12,30 m Performances Vitesse
à l'horizontale : 30,6 km/h
Le début des
années 20, vit poindre un engouement considérable pour le vol à voile et les
aviettes (moto-aviettes lorsqu'on les motorisaient). Dès sa création, la
SABCA suit deux politiques différentes. La construction sous licence d'appareils
d'origine étrangère, qui constitue sa principale activité et le développement
d'appareils de sa propre conception. Elle est aidée par le Gouvernement belge
qui crée une chaire aéronautique à l'Université Libre de Bruxelles et
construit à Rhode St-Genèse, un laboratoire aérotechnique pour donner au pays
les moyens de son autonomie. Dès lors, forte des connaissances techniques
accumulées en travaillant sous licence à des nouveaux moyens mis à sa
disposition, la SABCA se lance dans la réalisation d'appareil de sa propre
conception. Les premiers appareils sont des réalialisations modernes,
individuelles ou collectives, de membre de son personnel encouragés par
l'entreprise et destinés au tourisme ou au vole à voile. Les premiers
appareils sont des réalisations modernes, individuelles ou collectives, de
membre de son personnel encouragés par l'entreprise et destinés au tourisme
ou au vole à voile . Ils sont
nombreux et remportent tant de succès de 1923 à 1925 que la plupart des
planeurs et des aviettes de l'époque sont attribuées à la SABCA. C'est ainsi
que naissent l'aviette SABCA, le JULIEN SJ 1 et SJ 1A, les planeurs à moteurs
auxiliaires CASTAR et VIVETTE, la limousine SABCA DP, le planeur COLANHAN de
GLYMES, l'aviette MULOT, le biplan léger SABCA CAMGUL, l'hélicoptère FLORINE
1 et l'avion expérimental RUTTIENS.
Le
"CASTAR" La SABCA fut
donc un des premiers constructeurs à s'engager dans ce vaste mouvement
européen, essentiellement du fait de Paul Poncelet.
C'est le Commandant Georges Nelis qui engagea également Raoul de Glymes en 1930 à la SABCA. Raoul devint rapidement l'ami de Paul Poncelet. Celui-ci, passionné par les avions déjà avant la guerre, était contremaître de l'atelier bois de la SABCA. Il développa une aviette monoplan et monoplace avec aile en porte-à-faux, démontrant ainsi son savoir-faire en matière de construction robuste et légère, à l'époque où la construction des avions (biplans) tenait plus du cerf-volant que de l'engin aérodynamique. Il construisit son planeur avec des moyens rudimentaires en 1922 et 1923, dans une cave de la rue St-Vincent à Bruxelles. Il y avait consacré tout son temps libre et ses soirées pendant 8 mois. Il fut entièrement construit en bois (sauf les roues, essieu et manche à balai). Aucune commande n’était apparente. Paul Poncelet reçut le soutien de la SABCA, qui n'hésitait pas à encourager les initiatives de ses cadres et il put réaliser l'assemblage final dans un coin de hangar mis à sa disposition à l’aéroport de Haren-Evère
Premier fuselage du
Castar en construction
Baptisé
"CASTAR" et immatriculé 0-BAFG, le 18 juillet 1923, ce planeur
effectua son premier vol, piloté par Victor Simonet, devant un large public
et des nombreux photographes. Il fut catapulté par sandow (câbles
élastiques), le 10 février 1923 à Haren-Evère. Paul Simonet, qui doit le
piloter, désigne l'endroit et la direction dans laquelle il désire effectuer
les essais. Il arrête les détails du mode de lancement, le placement et la
tension des sandows, la retenue de l'appareil et les divers commandements
qu'il donnera. Ces commandements promptement exécutés, le planeur se libère
et effectue son premier vol en planant en ligne droite, à quelques mètres du
sol, pendant quelques secondes. Malgré la nuit tombante et la faiblesse du
vent, Victor SIMONET effectue trois nouveaux vols très réussis dont un de 115
mètres à des hauteurs d'environ 5 mètres. (La Conquête de l'Air, 1er mars
1923).
Le lendemain,
malgré une absence totale de vent, remorqué par une voiture, Simonet effectue
une douzaine de vols, dont le plus remarqué est de 225 mètres à une hauteur
de 20 mètres. Après d'autres
essais avec remorquage par automobile, il fut testé en vol plané à
Remouchamps et à Lixhe, près de Visé où il fit des vols d'une à deux minutes
avec gain d'altitude de cinquante mètres mais, lors du cinquième vol, Victor
Simonet cassa du bois et il fallut fabriquer un nouveau fuselage. L'opération
fut mise à profit pour y prévoir l'adaptation d'un moteur amovible Anzani de
7 CV. Lors de son premier vol motorisé, le pilote Victor Simonet accomplit un
vol de 45 minutes et monta jusqu'à 1100 mètres en survolant Bruxelles.
Le Poncelet
"Castar" avant les premiers vols à l'aérodrome d'Evère en février
1923. Le Castar prit
part au 2ème congrès de vol à voile à Vauville, dans le Cotentin, fin août
1923. Victor Simonet y remporta plusieurs trophées, deux premiers prix, un
second, et un troisième aux commandes du Castar configuré en planeur.
L'Aéro-club de Belgique organisa un meeting de moto-aviettes en septembre
1923, auquel participa le Castar gréé d'un moteur Coventry Victor bicylindre
de 16 CV, l’Anzani étant hors service suite à la perte d’un cylindre survenue
à Saint-Valéry-en-Caux lors du vol de convoyage vers Vauville où le Castar
arriva finalement par la route. Les performances du Castar muni de ce nouveau
moteur furent décevantes. Il fut dès lors opté pour le moteur Sergant, choix
qui devait s'avérer judicieux, car c'est avec ce propulseur que le Castar
franchit la Manche (en compagnie du Poncelet Vivette) en octobre 1923 pour
participer au concours d'aviettes de Lympne (Grande-Bretagne). Les
Britanniques ne tarirent pas d'éloges pour les performances et la qualité de
la construction des aviettes Poncelet.
le Castar motorisé n°
21 au concours avec le Lieutenant Victor Simonet pilote, Pour se rendre à
Vauville pour le congrès d’aout 1923, par la voie des airs, Victor Simonet et
Paul Poncelet l’équipent de son nouveau moteur. Il faut se souvenir que cet
appareil était un planeur que l'on a transformé en avionnette et non une
avionnette dont on a fait un planeur ! L’appareil prend
la direction du Sud en faisant escale à Valenciennes, Douai, Calais, Boulogne
et au Crotoy. Toutes ce étapes se poursuivent sans problèmes, quand le bris
en vol d’un des cylindres de son moteur immobilise l’appareil à St-Valéry-en
Caux où il doit atterrir. Il continua alors son périple par la route,
remorqué par Mr et Me Demonty (directeur de la SABCA) qui avaient quitté
précipitamment Vauville où ils étaient depuis le début du congrès. Il fut
remorqué par une voiture jusqu’au Havre, puis par bateau et enfin tracté par
un camion de l’armée française jusqu’à Vauville. Il y
retrouvèrent le commandant André Massaux et Henri Julien. Tour à tour,
chacun devint gardien des appareils ou dirigeant des équipes.
Le Castar tracté par
l’automobile de Mathieu Demonty, A Vauville, le
vaillant pilote du Castar, Victor Simonet, a dépassé des records obtenus
jusqu'à présent, battant des records du durée et il
remporta un grand succès et plusieurs trophées.
La "VIVETTE"
Une
particularité de ces aéroplanes était la position du réservoir d'essence, qui
est située juste derrière la tête du pilote, servait de protection à cette
dernière en cas de choc. De fait, au cours d'un accident, le réservoir joua
bien son rôle protecteur. Mais si dans le choc, le carburant s'était écoulé
et enflammé, le pilote se serait trouvé dans une situation très
précaire ! La Vivette
pouvait aussi être configurée en planeur, monoplace ou biplace, en y ajoutant
un deuxième siège directement derrière le siège du pilote, à la place du
réservoir de carburant, ce qui permit à Raoul de Glymes, d'accompagner son
ami et collaborateur Paul Simonet dans ses nombreux vols d'essais.
Le siège arrière et le
réservoir furent enlevés
La
« Vivette », fut offerte par son propriétaire, J-B Richard au
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (Bruxelles) en juillet 1926.
L'appareil fut radié par l'Administration de l'Aéronautique le 31 janvier
1931. Elle fut restaurée en 1995, dans les ateliers de Roger Poncelet
(petit fils de Paul), sous le patronage de la SABCA, à l'occasion des 75 ans
de l'entreprise. Elle fut accrochée vers 2002 aux douves du hall de
l'aviation du Musée (MRA).
La "Vivette"
dans le hall de l'aviation
§ Le "JULLIEN SJ.1" qui faillit
être construit en série et le SJ.2, dessiné par le jeune ingénieur parisien
Henri Jullien engagé comme chef de production à la SABCA débutante. § Le planeur monoplan COHALAN, étudié et
construit par l'ingénieur Raoul de Glymes, responsable qualité de la SABCA
(décrit précédemment). § Le "SABCA Junior",
planeur-poutre inspiré du Zöfling allemand. Le fuselage est une simple poutre
reposant sur un patin amorti et le pilote est assis juste en avant du bord
d'attaque. La voilure est rectangulaire en plans, dotée d'ailerons
classiques. §
Les succès engendrés à Vauville et dans différents concours
internationaux et les encouragements des autorités et des différents
aéro-clubs, poussèrent Paul Poncelet et l'ingénieur Mathieu
Le curieux SABCA DP
biplace aux allures de limousine aux iles repliables
MEETING expérimental de VAUVILLE
Le vent y étant
particulièrement favorable au vol à voile, de nombreux participants y furent
représentés. Comme en 1923, une épreuve était ouverte sur un parcours
quotidien Vauville – Carteret – Vauville.
25 juillet 1925 - Veille
de l'ouverture du Meeting Dès le matin, les trois appareils
belges prirent la ronde. La Vivette, pilotée par Albert
Massaux (N° de concours 29), suivie des 3 appareils de construction
françaises. Sur les 34 appareils inscrits (17
planeurs et 17 avionnettes), 11 participèrent au meeting, dont seulement 6
planeurs réussirent leur vol qualificatif et se révélèrent aptes à prendre le
grands vols. Un certain nombre de machines de petits constructeurs étant
encore inachevées. Malheureusement, le vol à voile, par
courants ascendants tel qu'il se pratique à Vauville, est, en raison du
relief accidenté du terrain et la violence des vents régnants, un sport très
dangereux qui nécessite d'excellents pilotes montant des machines éprouvée,
solidement construites et particulièrement bien étudiées. Le terrain de
Vauvile ne se prête donc pas aux petits inventeurs qui cherchent à réaliser
une idée nouvelle avec des moyens souvent précaires Il fut donc interdit de
laisser prendre le départ à des pilotes non brevetés ou à des appareils, soit
trop légers de construction, soit de proportions ou de centrage insuffisamment
étudiés. C'est la raison pour laquelle ne
prirent effectivement part aux épreuves que le planeur d'Afred Auger, et les
3 appareils belges, le Castar, la Vivette et le Colanhan de Glymes. Parmi les
autres concurrents, la plupart ne purent pas se qualifier par le vol
réglementaire de 10 secondes et seul, Robert Ferber tint à exécuter un vol
d'une vingtaine de minutes avec son biplan fait pour un tout autre terrain.
Ajoutons, que le 6 août 1925, le pilote Gaudin, prenant le départ pour la
première fois sur le planeur Peyret Abrial, fut nettement surpris par la
brutalité de l'envol et faisant une fausse manoeuvre, vint s'écraser sur le
sol d'une de 10 mètres. Seule, la forme spéciale du tandem Peyret, lui évita
un l'accident mortel. Enfin, la
planeur Landes-Breguet, arrivé dans les derniers jours du meeting, ne put
faire aucun essai concluant et ne put pas donner les résultats que le succès
des petits modèles construits par les frères Landes faisait espérer. Les seuls
planeurs et les pilotes sélectionnés pour pendre part aux épreuves,
sont donc :
Comme on peut le voir, la moitié des appareils étaient belges.
La SABCA présenta trois appareils dans sa catégorie de planeur : · Le monoplan Poncelet"Castar",
piloté par le Lieutenant Victor Simonet · Le monoplan
Poncelet"Vivette", piloté par le Commandant Albert Massaux · Le monoplan"de Glymes -
Colanhan", piloté par le Lieutenant Maurice Damblon. Maurice Damblon,
avec le planeur de l'ingénieur Raoul de Glymes, aurait pu être recordman du
monde du durée si il n'avait pas vécu une avarie
technique.
La"Vivette"en
configuration planeur, moteur retiré et capot abaissé Outre les 3 appareils belges de la SABCA, il y avait 3 appareils
français : · Le monoplan Perey Abrial « Vautour »
piloté par Albert Auger · Le monoplan piloté par Gaudin · Le biplan Ferber, piloté par Robert le
fils du pionnier d’aviation Ferdinand Ferbert
26juillet 1925, une journée mouvementée ! La journée malheureusement endeuillée par une chute mortelle,
fut cependant très fertile en performances et très forte enémotions ! A 9 h 55 minutes 18 sececondes, le lieutenant Maurice Damblon,
sur le planeur de GLYMES-COLANHAN prit son envol (n° de concours 30)
A 10 h 47
minutes 46 secondes, le Commandant Albert Massaux, sur le Poncelet
VIVETTE, s'envola à son tour (n° de concours 29). Il était bien connu des
familiers de l'aviation pour son audace et sa maitrise, autant que pour sa
bonne humeur.
Albert Massaux
Le vol de ces
trois machines était vraiment splendide, un véritable ballet aérien ! On
avait l'impression que les trois pilotes belges voulaient au cours de cette
première journée, battre le record du monde de durée, officiellement détenu
par Alexis Maneyrol avec 8 heures 4 minutes 50 secondes.
A 16 h 30
minutes, Alfred Auger décolla avec le planeur conçu par Georges Abrial et
construit par les Ateliers d’Aviation Louis Peyret de St-Cyr (France),
immatriculé A-02, et baptisé "VAUTOUR" (N° concours 18). C’était un
monoplan, monoplace à aile haute en bois.
Aéronaute,
Alfred Auger avait fait monter sur son planeur un instrument mis au point par
Raoul BADIN et déplacé de son ballon, appelé «Variomètre ou sustentiomètre »,
qui permettait de mesurer la vitesse d’un avion par rapport à l’air dans
lequel il évolue et de faire du pilotage sans visibilité de manière
contrôlée. Il indique également les vitesses verticales. Cet instrument était
devenu obligatoire en 1923 à bord des avions de transport civils. Raoul Badin
figure parmi les pionniers de l’aéronautique. Il consacra sa vie à la
sécurité aérienne et son nom est familier à tous les pilotes, depuis leur
formation initiale.
Le monoplan
Peyret Abrial « Vautour » avait été aménagé en laboratoire aérien. Auger
voulait tester le variomètre monté sur un mât derrière l’habitacle. Sous le
plan, au centre de gravité, on avait mis une planchette amovible destinée à
recevoir les instruments nécessaires aux mesures en vol. Un mât caréné,
prenait appui sur la planchette et sortait verticalement par l'extrados du
plan médian pour porter les indicateurs d'angle d'attaque et de vitesse. Les
tubes et les biellettes qui assuraient les connexions avec les enregistreurs
passaient par l'intérieur de ce mât.
Au cours de ce
vol, Auger avait atteint l’altitude maximale que lui permettait la vitesse du
vent sur la pente. Se laissant déporter par le vent pour éviter un grain, il
avait rencontré une ascendance qu’il ne connaissait pas, mais qui lui permit
de s’élever jusqu’à atteindre le plafond des nuages. Il fut aspiré par un
cumulus noir il battit le record du monde d'altitude avec 720 mètres, grâce à
un passage du vol de pente au vol thermique. Ce fut le premier vol thermique
français (involontaire) et le second au monde. Le 12 août 1926,
aspiré accidentellement dans un nuage d'orage, le pionnier allemand Max Kegel
gagne environ 2.000 mètres d'altitude en raison des courants ascendants dans
le nuages et parcourut ensuite une distance de 55,2 km, c'était un record du
monde.
Vers 16 h, peu avant l'atterrissage d'Auger le
chronométreur M. Matabon et le commissaire qui suivait le vol des planeurs,
signalèrent la disparition du planeur « Castar » de Victor Simonet. Il ne
réapparaît pas et une voiture part à sa recherche. Nulle inquiétude encore.
On pense que Simonet a tout simplement atterri quelque part vers Sionville.
Van Opstal qui va prendre le départ pour la course quotidienne des aviettes
prévient que s'il voit le planeur de Simonet, il lancera un message situant
le lieu d'atterrissage, afin qu'on aille le dépanner. Van Opstal et et son
coéquipier lancèrent à leur premier passage au dessus du terrain un plan
situant l'endroit où Simonet était descendu. C'était dans le ravin de Biville
! Des alternatives d'espoir et d'inquiétudes et des bruits contradictoires
arrivèrent. C'est seulement vers 18 h que la nouvelle officielle tomba. On a
retrouvé le pauvre Simonet tué à côté de son appareil brisé.
Victor Simonet,
ancien collègue de la Ligue Française du Cerf-Volant, s'était consacré à
l'exploration aérienne, et ses observations aérologiques contribuèrent
beaucoup au progrès du vol à voile. Il était considéré comme l'as du vol à
voile et le triomphateur du meeting de Vauville 1923.
Ces deux
accidents furent tous les deux dus à des ruptures de commande. Rupture de la
commande de profondeur de Simonet, et rupture de la commande de gauchissement
de Damblon. Les câbles utilisés par les planeurs belges étaient des câbles du
type rigide et non les câbles extra souples employés en France pour les
commandes. Sous l'action des pliages alternés, les fils se brisent un à un
jusqu'à rupture complète du câble. Le même accident se produisit d'ailleurs
sur l'avion du commandant Massaux, dont le câble de rappel des pédales de
direction se brisa également, mais la rupture de cette liaison non
indispensable au pilote, ne provoqua pas d'accident. Toutefois,
l'ingénieur Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE pouvait être très fier de son
œuvre !
Le vol à voile
est un sport, mais il est aussi un moyen scientifique d'expérimentation
aérodynamique et de recherches pour le progrès de la science. Il fut donc
intéressant de constater que lors du Meeting de Vauville, on essaya pour la
première fois, d'utiliser le vol à voile pour une expérience vraiment
scientifique. Ce meeting expérimental permit de sortir du "sport
pur" et se transformer par l'emploi d'instruments de mesure et une
méthode nouvelle d'expérimentation aéronautique. Sans doute, il y a encore beaucoup
à faire, mais l'impulsion donnée n'a pu qu'être positive pour le progrès
scientifique.
Différents prix
furent attribués : 12.000 FB. Le commandant
Albert Massaux, plus jeune et plus endurant, s'était fait la spécialité de
durée et se vu attribuer également une prime de 12.000 FB. Dans la
catégorie "expérimentation de maquettes en grandeur", le prix fut
décerné à l'ingénieur Raoul de Glymes car son planeur était la réduction exacte
d'un avion de bombardement trimoteur étudié à la SABCA. Une prime de 10.000
FB lui fut attribuée.
Ecrit par
Raoul de Glymes pour son ami Victor Simonet - (La
conquête de l'air 1925 - Août - Septembre 1925)
"Simonet n'est plus !
Le vol à voile
est un sport, mais il est aussi un moyen scientifique d'expérimentation des
avions. Est-il utile au progrès de la science aérodynamique ? Faut il se
décourager après le malheur qui nous frappe ?
LE PLANEUR LABORATOIRE Les essais des
modèles réduits au laboratoire (soufflerie) sont de nature à nous fixer sur
la résistance de l'avancement, la portance et l'emplacement ainsi que sur le
point d'application des résultantes d'où l'on peut déduite l'emplacement du
centre de gravité pour que l'avion soit stable statiquement en courant
uniforme, mais ces résultats doivent subir de multiples corrections assez
importantes.
Bientôt, les
planeurs permettrons aussi la détermination des
caractéristiques visant le reconstitution de la polaire en vol à voile. Pour
que cela soit possible, il fallait deux choses :
1° une station permanente de vol à voile (elle existe à Vauville) En ce qui concerne les caractéristiques, si nous supposons que
le planeur est un stationnement relatif (immobile par rapport à
l'observateur) en courant d'air uniforme, la mesure d'angle d'incidence par
rapport à l'horizontale jointe à celles de la direction du vent et de la
vitesse du vent, suffisent aux calculs de chaque point de la polaire, car le
poids des appareils est connu. Au point de vue
expérimental, ses mesures pourront se faire à bord, sans que le pilote ait
besoin d'immobiliser son planeur par rapport au sol, l'instrument de MM Coune
et Vorobeitchik de la SABCA remplit ce désiteratum.
La comparaison des résultats d'essais effectués sur petit modèle dans une
soufflerie avec ceux réalisés en vol vont nous
réserver certainement beaucoup de surprises et la lumière pourra se faire sur
beaucoup de points obscurs actuellement, concernant les réactions
aérodynamiques. "Raoul de
Glymes"
LE PLANEUR D'ETUDE (Raoul de Glymes) Le planeur a été de tout
temps le précurseur des avions. Il est en sommes, la base expérimentale des
formes à donner aux avions. Aujourd'hui, que la finesse des avions est plus
que jamais recherchée pour l'avenir de l'aviation commerciale, les
expériences de vol à voile sont de plus en plus utiles. L'apparition des
avions gros porteurs à faible puissance dans l'aviation commerciale allemande
crée une ère nouvelle d'aviation économique de laquelle dépend
essentiellement l'avenir des transports aériens. Il n'est pas osé de dire en
1925, que les avions actuels "gros gaspilleurs de puissance" ont
vévu.
"Les recherches et les expériences auxquelles le vole à voile à donné lieu ont bien servi la cause de l'Aéronautique. Elles ont d'abord permis à nos pilotes de battre les reccords retentissants établis par les aviateurs allemands et elles ont orienté nos contructeurs dans une voie qui aboutira certainement à l'amélioration sensible des qualités aérodynamiques des voilures" Ces paroles de Laurent
Eynac, écrites en 1923, paraissent écrites aujourd'hui (1925) pour mieux
faire ressortir toute la portée des records du monde retentissants que
Damblon et Massaux viennent successivement de battre à Vauville pour la plus
grande gloire de l'aviation belge.
Raoul de GLYMES
En 1927, Raoul
de Glymes signe pour un avion monomoteur, le DG-10. L'ingénieur Raoul de
Glymes a conçu un monomoteur monoplan à aile haute qu'il fit construire à ses
frais par le menuisier d'une entreprise bruxelloise. Le SABS n°1 L.B.T. fut
inscrit le 15 juin 1927 au nom de la S.A pour l'application de brevets, sise
à Bruxelles, sous la matricule 0-BAFY.
Le 22 août 1931, le lieutenant colonel ISERENTANT, Président de la commission sportive de l'Aéro Club Royal de Belgique, organisa un rallye aérien dont les épreuves visaient à l'endurance du pilote, à la connaissance parfaite de ses itinéraires et à des exercices très précis de navigation. Bob VANDEVELDE y participa avec le DG-10 et fut classé premier, ce qui lui permit d'équiper l'appareil d'une splendide boussole, car les prix consistaient en bons d'achat de matériel aéronautique. L'appareil monomoteur 00-AKV vola durant plusieurs années et fut rayé des registres le 8 mai 1935 pour une raison inconnue. Le 5 novembre 1930, suite au succès remporté pas le DG-10, Raoul de Glymes étudia et dessina les plans du DG-11, avion bimoteur de tourisme, dont le projet fut remis à Direction de l'Aéronautique Civile. Ce projet fut primé et il reçut un prix de 15.000 francs belges de l’époque. Cependant, l'appareil ne vit jamais le jour et la crise économique, mit un frein à la carrière de constructeur d’aéronefs de l'ingénieur Raoul de Glymes de Hollebecque.
Le 30 avril 1949, Raoul de Glymes fut nommé Major honoraire de réserve de la Force aérienne belge.
Le 15 novembre
1949, il fut promu Commandeur de l'Ordre de Léopold II.
13 février 1954,
il reçut à l'exposition nationale du travail, la médaille commémorative du
travail.
En novembre 1954, le dossier complet fut transmis à la Direction de l’Administration de l’Aéronautique, 53 Boulevard du Régent à Bruxelles. Dans une lettre adressée à André Watteyne, datée du 13 octobre 1958, Raoul de Glymes signalait qu’il allait envoyer directement l’avant projet de l’avion DG-12 au service de l’Aéronautique française !
Raoul assistait avec son épouse
Madeleine Barbe à de grands bals organisés par le Club de Officiers
"Mars er Mercure", dont celui organisé le 26 décembre 1955 à
l'Hôtel Atlanta à Bruxelles et en 1956, à celui des Officiers de réserve à
l'Eden Palace. En 1956, il s'était établi au 68, rue Voie de Liège à Herstal, juste en face de la F.N où il travaillait.
MANIFESTATION AERONAUTIQUE D'HAREN
Il y avait
également le Saint-Hubert, mû par un moteur Hermès de 105 cv, création de M.
Orta, l'avion léger à ailes hautes de WIELEMANS, équipé d'un moteur Scrorpion
de 35 cv et enfin de WAUTERS d'OPLINTERS, un petit appareil en cours de
construction dont le moteur Salmson de 40 cv permettait d'atteindre 180 km/h.
CONGO BELGE
En 1919, le
gouvernement a été fondé par la Régie industrielle des mines de Kilo-Moto.
Elle est transformée en février 1926 en une société de droit congolais, la
Société des Mines d'Or de Kilo-Moto SCRL (SOKIMO). Le siège de la société
était à Kilo (Congo belge) et son siège social administratif était situé à
Bruxelles, 1 Place du Luxembourg.
Village des cadres de
la Mine à gauche et Village des travailleurs de la Mine à droite
photo à venir
La "BRETAGNE" est un vaisseau
rapide mixte, trois mâts, à trois ponts inspiré du "Napoléon", mais
conçu par l'ingénieur polytechnicien Julien Marielle (1817-1897), construit
au chantier naval de Brest et lancé en 1855. La décision de le motoriser a
été prise après la mise sur cale. Il est le seul de son type. La machine de 1
200 CV comprenait un « appareil évaporatoire » de huit corps de chaudières à
cinq fourneaux chacun, et qui permettait de filer 13,5 nœuds (25 km/h)
environ. Il consommait 150 tonnes de charbon par 24 heures. L'hélice à deux
ailes doubles pouvait être remontée afin de ne pas gêner la marche à la
voile. La machine était composée de deux cylindres. Le vaisseau fut retiré du service actif
de la flotte en 1866 pour servir de caserne, puis de navire-école aux novices
et apprentis marins en rade de Brest. Il sera définitivement condamné en 1879
avant d'être démantelé l'année suivante :
Après sa
retraite, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE, vécut avec sa femme à Paris, dans
le 1er arrondissement, au 4 rue St-Florentin ou il consacra
son temps à fabriquer de plus petites maquettes de bateaux anciens,
entièrement construites avec du matériel de récupération, des boîtes de
cigares, des allumettes, etc.....
Maquette réalisée pour
son petit fils Gérard Dassonville
Raoul de Glymes de Hollebecque a été décoré pour ses nombreuses missions.: Major honoraire
SOURCES
Site réalisé par Laure DASSONVILLE
|